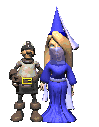| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

les instruments de l'époque médiévale

Présenter les instruments de musique du Moyen Âge peut sembler paradoxal : nous n'avons pratiquement conservé aucun exemplaire authentique d'avant le XVe siècle.
Si nous avons accès à cette culture musicale et si nous pouvons en reconstituer les instruments, c'est donc uniquement par les écrits et l'iconographie. Les documents qui nous permettent d'en avoir une idée concordent avec le début de l'écriture musicale au IXe siècle et ne sont guère utilisables avant le Xe siècle.
Les représentations d'instruments, ainsi que les citations à leur sujet, deviennent très abondantes au cours des XIIe et XIIIe siècles, elle donnent un aperçu assez précis des formes et des techniques de jeux des différentes familles. Ces images et ces textes appellent immédiatement à faire cette constatation : sous des aspects parfois identiques, une bonne partie d'entre eux existe encore dans le Maghreb, les Balkans et le Moyen Orient. L'instrument médiéval se rattache ainsi à l'ensemble de la culture musicale du bassin méditerranéen. Quant à savoir si cet apport vient d'une tradition ancienne, d'une influence orientale par les croisades ou de la présence, en Espagne, de la culture mauresque, il est difficile de le définir, car l'ensemble des trois facteurs doit très certainement être pris en compte.
On doit savoir aussi que, jusqu'à la Renaissance, les documents que nous possédons n'offrent des renseignements sur la pratique musicale que sous deux aspects : liturgique et féodal, c'est à dire savants, intellectuels et aristocratiques; nous ignorons pour ainsi dire tout des courants traditionnels et populaires.
Les instruments sont alors classés en deux familles définies par la puissance de leur sonorité : les hauts instruments (ceux dont le son est puissant), réservés aux fêtes et aux cérémonies, et les bas instruments (ceux dont le son est doux), qui sont ceux des musiques plus savantes.
Les instruments à vents :
Les flûtes :
La flûte à bec : Souvent désignée sous le nom de flûte d'Allemagne, le son est produit par un sifflet. Les instruments très graves (grande basse, contrebasse) et très aigus n'apparaîtront qu'à la Renaissance.
Le gemshorn : Son nom allemand, littéralement cor de chamois, est plus fréquemment employé que sa désignation française : corne de flûte, pourtant plus appropriée. Il s'agit en effet d'une flûte et non pas d'un cor (haut instrument). Le gros bout de la corne est entièrement obturée à l'exception d'une petite fente par laquelle on souffle. Le principe est à la fois celui d'une flûte à bec et d'un ocarina (flûte bouchée). L'émission du son le plus grave est assurée par un tout petit trou placé vers le bout de la corne. Son grand volume d'air permet une conduite expressive du son remarquable, mais sa justesse est assez difficile à contrôler.
La flûte traversière : Le son est produit par le souffle sur le bord d'un trou appelée embouchure (à ne pas confondre avec celles des trompettes). Au Moyen Âge, c'est la flûte la plus représentée. En bois et sans clef, elle ne se modifiera pas avant le classicisme.
Le gaboulet-tambourin : Le gaboulet est une sorte de flûte à bec dont le son, modulée à l'aide du soufflet et de trois trous, utilise les harmoniques les plus élevés. Il se joue d'une main, l'autre une petit tambour. Le gaboulet, au son très percé, se classe parmi les hauts instruments.
Les anches :
La chalemie : employée jusqu'au XVe siècle, on en trouve deux formes : l'une trapue, évasée, identique au hautbois d'Afrique du nord et une autre plus allongée. La bombarde (anche double) XVe-XVIe siècles : est munie d'au moins une clef, protégée par un élément décoratif appelé fontanelle. Elle existe en famille : la plus grande, la basse, mesure à peu près trois mètre. Le chalumeau (anche simple), souvent à deux tubes à l'image de certains instruments balkans, il semble avoir eu un rôle surtout populaire. Il est peu représenté mais souvent cité dans les chansons qui utilisent le registre campagnard, les pastourelles.
La muse ou musette, la cornemuse : Le mot cornemuse est récent. C'est déjà un instrument à connotation populaire, très lié à la danse. Elle n'ont alors qu'un seul bourdon.
La douçaine ou dulciane est, comme son nom l'indique, un instrument à anche à son doux. C'est l'ancêtre direct du basson et sa construction est identique : son corps ovale dissimule une double perce, la longueur réelle du tube fait donc deux fois la taille apparente de l'instrument. Elle apparaît entre le XIVe et le XVe siècle. Elle existait en famille : de la basse au soprano. C'est la basse qui deviendra le basson au cours du XVIIe siècle.
Les embouchures :
La saqueboute : ancêtre direct du trombone. De son relativement doux, cet instrument était souvent employé dans les fêtes de la liturgie.
La trompette : le plus souvent droite, elle n'a pas beaucoup changée depuis l'antiquité.
Le cor ou trompe : cornes de tailles diverse, ce sont des instruments d'appel. On trouve souvent cité le cor sarrasinois. Olifant, est une trompe taillée dans une défense d'éléphant (ou d'autres animaux). Son prix le réserve à la noblesse.
Le cornet : Instrument à embouchure mais muni de trous comme la flûte. Il semble apparaître au cours du XIVe siècle. Il faut distinguer deux modèles, le cornet muet, droit, et le cornet courbe. Le cornet courbe est construit en bois en deux parties collées et recouvert de cuir.
Les orgues :
Haut et bas instruments à la fois, l'orgue introduit en Europe à l'époque de Charlemagne. On dit que le premier instrument fut offert par une mission diplomatique de Byzance à l'Empereur qui en recommanda l'emploi. Le Moyen Âge en connaît trois formes : l'orgue de choeur de plusieurs jeux (le plus grand), l'orgue positif, en général d'un seul jeu, et l'orgue portatif qui se joue à une main. Il n'y a pas d'orgue en buffet à cette époque.
Les cordes :
Les cordes pincées :
Le luth : Important de l'ud oriental, l'orthographe médiévale (leu, lut) leur est encore proche de l'arabe. Il apparaît dans l'iconographie vers 1250. Jusqu'à la fin du XVe siècle, son manche court sera muni et démuni de frettes et il sera monté de cinq rangs de doubles cordes en boyaux pincées au moyen d'un plectre. En occident, il se modifiera considérablement : joué aux doigts à partir de 1480, le nombre des cordes augmentera régulièrement. Il sera abandonné en Europe dans les premières années du XIXe siècle.
La guitare sarrasine, guiterne sarrasinoise, guiterne morache : Luth à long manche proche des actuels saz et tambur turcs. Avec trois rangs de cordes, elle sera utilisée jusqu'au début du XVe siècle. Il est toujours muni de frette et semble avoir un descendant direct : le colachon (colascione) qui sera l'instrument des comédiens italiens jusqu'au XVIIIe siècle.
La guitare dite latine : guiterne. Plusieurs formes : ovale, cintrée... Munie de trois ou quatre rangs de double cordes. À la fin du Moyen Âge, seule la forme cintrée restera utilisée. C'est l'ancêtre de la guitare actuelle. Au XIIIe et XVIe siècles, son nom se confond souvent avec celui de la citole, instrument multiforme et imprécis, plus ou moins en forme de houx et dont la continuation pourrait être le cistre à corde de métal de la Renaissance.
La harpe : sa forme est très fixée et elle ne changera pratiquement pas jusqu'à la fin du XVIe siècle. Petite, peu de cordes (entre 20 et 30), elle ne permet pas le chromatisme. Très appréciée, c'est, avec la vielle à archet, l'instrument des poètes et des seigneurs du Moyen Âge. Le luth la supplantera dans le registre courtois, à partir de la deuxième moitié du XVe siècle.
Le Psaltérion canon, micanon :Très abondant dans l'iconographie, il est toujours joué à l'aide d'un plectre. Sa taille et sa forme sont variables. Certains sont proches de l'actuel kanon d'Afrique du nord.
L'escachier d'Angleterre : clavier à cordes pincées. Ancêtre de l'épinette et du clavecin, cité à partir du XIVe siècle. Rarement représenté, sa forme est très hypothétique.
Les cordes frappées :
Le tympanon : instrument très semblable aux psaltérions, la différence essentielle est la technique des mailloches très visibles dans l'iconographie. Il sera employé jusqu'au XVIIIe siècle. L'Europe centrale et le Moyen Orient en ont gardé de nombreuses formes : cymbalum, santur...
Le clavicymbalum : ce clavier n'est connu que par quelques citations et par un plan dans un traité de lutherie (Arnaud de Zwoll) du XVe siècle. C'est un instrument au mécanisme complexe et qui n'a pourtant eu aucune filiation directe : le clavicorde est un instrument de facture beaucoup plus simple. C'est sans aucun lien avec lui que le piano forte apparaîtra trois siècles plus tard.
Les cordes frottées :
Les archets : quelque soit l'instrument, des premières représentations jusqu'au début du XVIe siècle, l'archet est toujours en forme d'arc. Ce n'est qu'à la Renaissance qu'il se modifiera pour se rapprocher de l'archet moderne.
Le rebec : d'origine arabe (rebab), il sera joué jusqu'au XVIIIe siècle. Au Moyen Âge, il se tient le plus souvent sur les genoux. Par la suite, cet instrument sera une version populaire du violon. L'ensemble caisse-manche-cheviller était souvent fait d'un seul morceau de bois (monoxyle). La gigue et la rote souvent citées sont difficile à différencier de celui-ci.
La vielle : multiforme comme les guiternes et les citoles : ovale, feuille de houx, cintrée. C'est l'ancêtre des violons et des violes de gambe. Au XVe siècle apparaissent des modèles de grande taille et de tessiture grave déjà très proche de la viole de gambe. La lyra est une vielle à trois cordes alors que la gigue n'en possède qu'un et a une forme compacte.
Le monocorde : future trompette marine du Bourgeois Gentilhomme, est muni d'un chevalet placé en porte à faux et qui, ainsi, vibre contre la table d'harmonie. La portée du son est assez grande et peut rappeler de loin le timbre de la trompette. Son utilisation ultérieure comme corne de brume sur les tableaux, lui donnera son deuxième nom Le crwt (prononcer crouth). Cet instrument dont l'orthographe indique l'origine galloise est une lyre à archet.
La chiffonie (symphonie) et l'organistrum - la vielle à roue : les cordes sont frottées par une roue archet actionnée avec une manivelle par la main droite, et les notes produites par un clavier joué de la main gauche. La chiffonie est alors un instrument doux, et à l'époque baroque, la multiplication des bourdons ainsi que l'usage d'une pièce de bois vibrante (chien ou tromptette) transformeront beaucoup cet instrument. C'est à cette période qu'il prend le nom de vielle à roue. L'Organistrum (XIIe et XIIIe siècle) est une chiffonie géante et grave que l'on jouait à deux, l'un tournant la manivelle, l'autre actionnant les torettes qui formaient un clavier simplifié.
Les percussions :
Au Moyen Âge et à la Renaissance, on trouve beaucoup de percussions de type tambour mais aussi beaucoup de sonnailles diverses, utilisées dans la musique de danse et de divertissement : cloches, grelots, sistres...
Le tambour (nom ancien tabour).
Le tambour plat, similaire au bendhir d'Afrique du Nord. Il est souvent représenté joué avec des baguettes.
Le tambourin.
Les Naquaires, double cymbales de taille petite ou moyenne, en poterie ou en métal. Le nom est d'origine arabe et elles sont proches des bongos marocains.
Le triangle est toujours représenté par deux anneaux vibratoires jusqu'à la Renaissance.
La cymbale était à l'origine deux coquilles que l'on frappait l'une contre l'autre. Les modèles plats apparaissent en Angleterre au XIIIe siècle.
Le carillon, jeu de petites cloches accordées. Il est plus lié à la musique religieuse qu'au divertissement.
La cloche.
L'échelette médiévale est une série de lames de bois attachées par des cordes. Elles ont évolué pour devenir le xylophone. On les retrouve sous le nom de claquebois ou orgues de paille.
Source : Métiers du classique